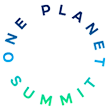Rassemblant gouvernements, acteurs non gouvernementaux et acteurs privés, la Coalition pour le carbone bleu a pour objectif d’accélérer l’investissement dans les puits de carbone côtiers.
Les zones humides côtières – mangroves, marais salants et herbiers – ont un rôle considérable à jouer en matière d’atténuation et d'adaptation au changement climatique. Lorsqu'ils sont protégés ou restaurés, ces écosystèmes séquestrent et stockent des quantités très importantes de carbone dans les plantes et les sols sous-jacents. C’est ce qu’on appelle le carbone bleu.
Cette dernière décennie, des progrès remarquables en matière de connaissances, de politiques et d'outils axés sur les écosystèmes côtiers ont été réalisés. La compréhension de leur couverture géographique, de leur dynamique temporelle en termes de superficie (perte ou expansion) et de leur contribution à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique s’est beaucoup améliorée.
de potentiel d’atténuation d’ici 2050 si tous les écosystèmes côtiers de la planète sont protégés et restaurés.
La COP26 de Glasgow a constitué un tournant dans la reconnaissance du carbone bleu comme solution naturelle essentielle face au changement climatique. Alors que l'intérêt augmente et qu'un nombre croissant d'investissements carbone bleu sont mis en œuvre par les gouvernements, organisations et entreprises, il faut veiller à ce que l’ambition soit au rendez-vous et que les projets aient le plus grand impact positif possible sur le climat, la biodiversité et les communautés, et ce grâce à la définition des normes scientifiques élevées et d’avantages pour les communautés autochtones et locales.
L'objectif est de développer des modèles de protection des écosystèmes qui aient des bénéfices sur les conditions de vie des populations, en mettant l'accent sur les pays les moins avancés (PMA), les peuples autochtones et les communautés locales.
En février 2023, la coalition a été intégrée à l'International Partnership for Blue Carbon sous la forme d'un High Level Ambition Group réunissant des champions du carbone bleu. A ce jour, ce groupe réunit la France, Conservation International, l'Australie, le Costa Rica et Monaco.
L'International Partnership for Blue Carbon a été lancé en 2015 dans le cadre de la COP21 à Paris et opère désormais sous les auspices de l'IOC-UNESCO. Il est composé de 55 membres dont des organisations internationales et régionales, des institutions gouvernementales, des ONG et des institutions de recherche. Sa mission principale et de protéger, assurer une gestion durable et restaurer les écosystèmes côtiers de carbone bleu qui contribuent à l'atténuation du changement climatique, à la biodiversité, aux économies bleues et aux moyens de subsistance des communautés côtières.